En Suisse, chaque année, nous gaspillons 2'800'000 tonnes de nourriture, dont 100’000 tonnes de pain. Si ces chiffres sont difficiles à appréhender, comprenons bien qu’un quart des produits de boulangerie sont destinés à la poubelle.
A Levain, le modèle de vente par abonnement et le système de production minimaliste, que nous avons mis en place tous ensemble, nous ont permis de réduire grandement les pertes liées aux étapes de transformation. En outre, la panification au levain naturel, que nous entreprenons quotidiennement, tend à accroitre la durée de vie du pain favorisant ainsi l’entière consommation des miches.
Une fois le pain livré, ces quelques efforts initiaux peuvent être complétés par de bonnes pratiques de conservation domestique, que nous souhaitons vous transmettre ci-contre.
Comprendre le vieillissement du pain
Le rassissement
Le rassissement concerne la rétrogradation de l’amidon dans son état naturellement arrangé.
Lors de la cuisson et sous l’effet de la chaleur, l’amidon contenu dans le pain se dilate jusqu’à son explosion. C’est ce qu’on appelle la gélatinisation. Avec la coagulation des protéines, elles marquent la transformation irréversible d’une pâte crue en pain chimiquement cuit. C’est grâce à cette modification de l’état de l’amidon que le pain obtient ses qualités viscoélastiques particulières (moelleux et souplesse de la mie). Cet état instable et désorganisé de l’amidon n’est, néanmoins, que temporaire. Au fil du temps, l’amidon a effectivement tendance à se réorganiser dans un état moléculaire stable. Ce processus est ce qu’on appelle la rétrogradation, plus communément appelé « rassissement ». Dans ses premières étapes, le rassissement confère au moelleux original, une sensation plus gommeuse. Puis, lorsque l’amidon est pleinement rétrogradé, le pain devient beaucoup plus dur.
Notons ici que, si un pain sec est toujours consommable (une biscotte fragile et cassante ne pose de problème qu’à une minorité), un pain rassis ne l’est plus (la même biscotte sera bien plus solide et presque impossible à mâcher).
Rajoutons que le rassissement ne peut intervenir qu’en la présence d’eau. L’amidon ne peut donc pas rétrograder lorsque le pain est préalablement séché, ni quand le pain est congelé. Ce phénomène est, par ailleurs, graduel. En effet, plus l’eau est disponible et plus le rassissement se fait rapidement. La diminution de l’hydratation d’une pâte à pain réduit donc la vitesse à laquelle un pain rassis.
Si l’on constate, alors, qu’il est difficile de lutter simultanément contre le séchage et contre le rassissement, il est possible de souligner que les matières grasses contraignent la réorganisation de l’amidon (les brioches rassissent en effet moins vite que les pains) et que les acides (produits par les bactéries d’un levain naturel) et les fibres (présentent dans les farines complètes) agissent positivement, en piégeant une fraction de l’eau disponible.
Cette dernière observation peut être complétée par l’action des amylases bactériennes (du levain), qui favorisent la production de dextrines ou de maltodextrines lors de la cuisson. Ces petites molécules étant très mobiles, elles s’immiscent entre les chaînes d’amidon et préviennent ainsi leur réorganisation.
Voilà pourquoi les pains au levain se conservent mieux que leurs frères fermentés à la levure.
De l'intérêt du toast ?
Enfin, il est utile de savoir que si l’on soumet une nouvelle fois le pain à une source de chaleur, l’amidon subira la même désorganisation que lors de la cuisson initiale. C’est là tout l’intérêt du « toast », qui permet à un pain qui semblait sec, de retrouver une « deuxième vie ». Or, si la mie peut redevenir moelleuse, c’est bien que le pain n’était pas sec (il y a toujours de l’eau dedans sans quoi la mie resterait dure), mais qu’il avait commencé à rassir.
Le séchage
Le séchage suppose la perte progressive de l’eau contenue dans le pain. Dans un environnement ambiant plus sec que le pain lui-même, l’eau migre, en effet, de ce dernier à l’extérieur. Notez, que dans un environnement humide (e.g. sous les tropiques), c’est bien l’inverse qui se produit. L’eau migre de l’air humide dans le pain.
La partie du pain qui est prioritairement concernée est la croûte. Cette dernière étant totalement dépourvue d’eau, elle sera la première à perdre ses caractéristiques initiales (croustillance, croquant) en réabsorbant l’humidité contenue dans l’air et/ou dans le pain. A terme, le séchage complet du pain résulte en une miche totalement dépourvue d’eau. Cela lui confère, au même titre qu’à une biscotte, une mâche cassante et fragile.
Il est possible de limiter ce processus par des emballages et par la congélation (voir ci-dessous), mais également en évitant d’exposer le pain à l’air libre (en ne prétranchant pas le pain) en particulier quand il est encore chaud (fort dégagement de vapeur, qui implique une grande perte d’eau).
A noter, que le séchage est un procédé de conservation qui a fait ses preuves. En effet, en soustrayant rapidement l’eau au pain, on prévient efficacement son rassissement, ainsi que l’apparition des moisissures (voir ci-dessous).

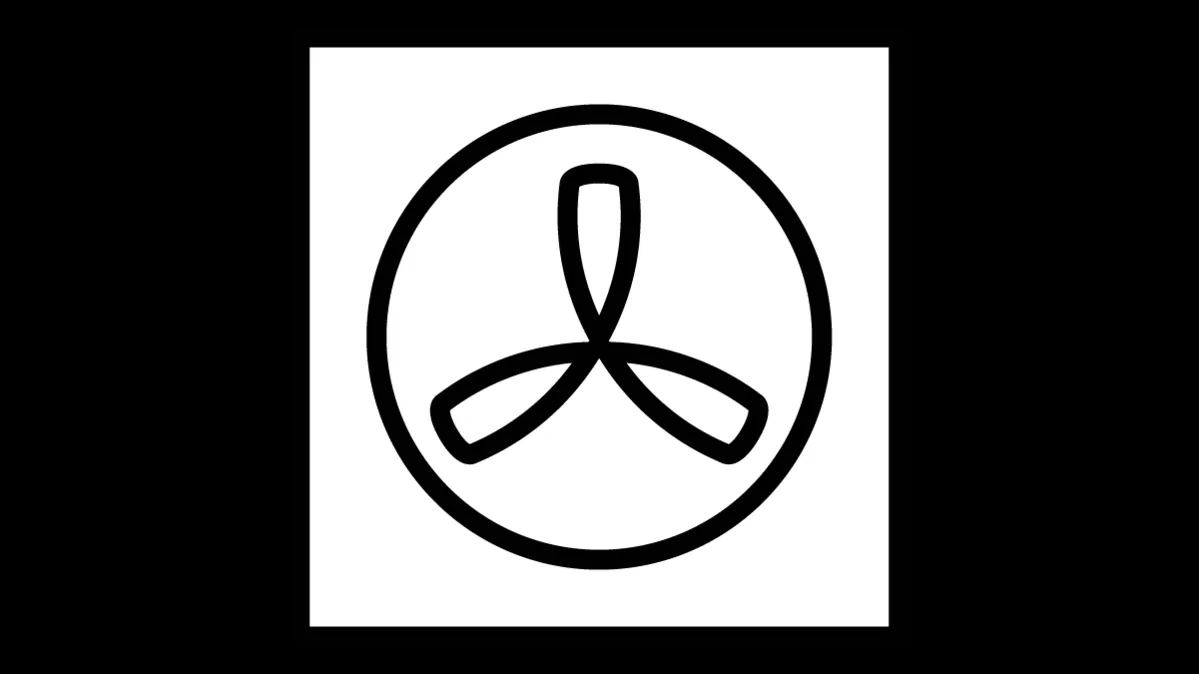
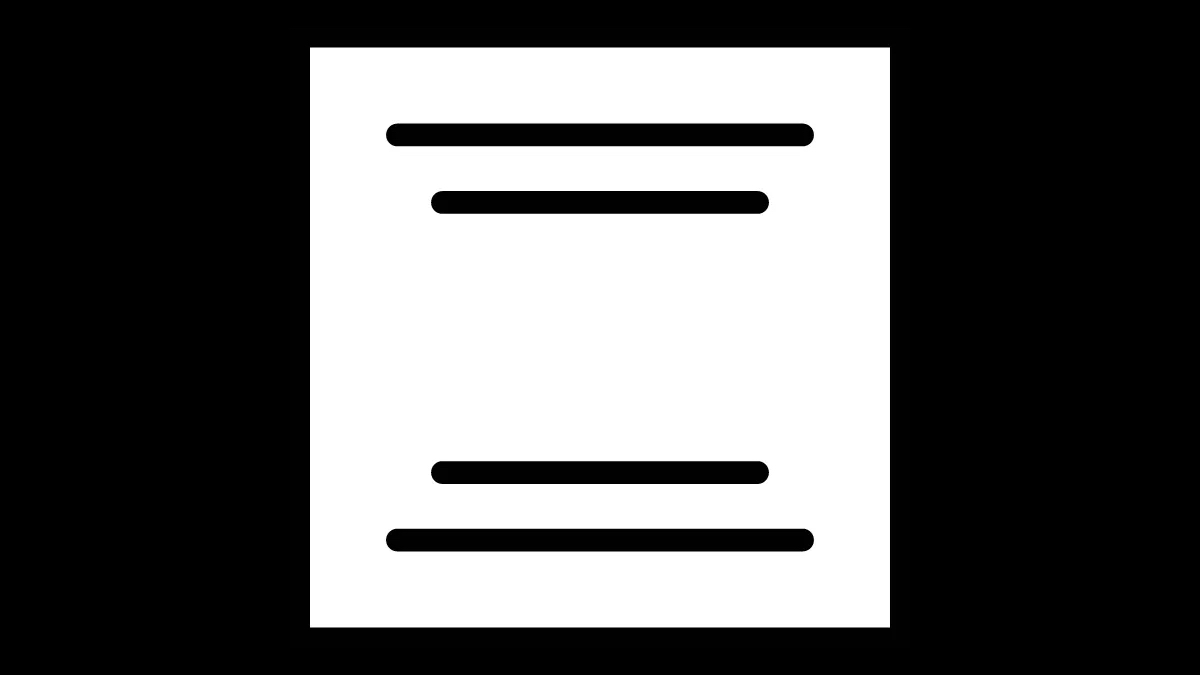
Quels emballages ?
De manière générale, il s’agit de conserver, le plus longtemps possible, les propriétés originelles du pain (croustillance, moelleux, etc.), en réalisant un compromis entre son séchage et l’apparition des moisissures.
A la maison, différentes options s’offrent à vous et sont à mettre en relation à l’environnement ambiant et au type de pain reçu.
Commençons avec le sac en lin, qui vous est proposé lors de votre souscription à Levain. Ce dernier est idéal pour la conservation de la grande majorité des pains que vous recevez, car il prévient un séchage rapide (du aux courants d’air par exemple) tout en laissant respirer le pain. Sa porosité évite à la croûte de ramollir trop vite et le contraste initial avec la mie est donc préservé. En cas de fortes chaleurs, nous vous invitons à le conserver à l’extérieur de tout tiroir ou autre espace de stockage (dans une corbeille sur le plan de travail par exemple). Lorsque la température tombe, vous pouvez tout à fait ranger votre pain et son sac dans un tiroir ou un autre espace.
L’idée, ici, est d’éviter un environnement à la fois chaud et humide qui favorise grandement l’apparition de moisissures, tout en réduisant l’exposition du pain à l’air libre (séchage).
Il est évidemment possible d’utiliser d’autres tissus, comme le coton, mais les résultats peuvent varier légèrement (en fonction de la porosité des tissus).
Lorsque vous recevez un pain dont la croûte est discrète et que le contraste avec la mie est moins flagrant (comme certains pains de seigle, pains moulés ou ciabatta par exemple), il est tout à fait possible d’opter pour un contenant plus hermétique (comme les sacs compostables blancs que nous utilisons pour les brioches par exemple). Le pain peut ramollir mais ça n’influencera pas sa dégustation et il se préservera plus longtemps (pas de séchage).
! Attention !
Si vous optez pour un contenant plus hermétique encore (sac plastique, huche à pain métallique très remplie) la remarque sur la chaleur et l’humidité est encore plus valable. En effet, un contenant parfaitement hermétique fera rapidement apparaitre des champignons (moisissures) par manque d’aération, et cela, même si la température de votre cuisine est plutôt basse 18°C.
Si vous optez pour un contenant parfaitement hermétique (par exemple du plastique enroulé au contact du pain), il sera préférable d’opter pour un stockage au frigo. Un parfait exemple est la conservation du pumpernikel, qui peut facilement excéder les 2 semaines pour autant qu’on l’emballe hermétiquement sous cellophane et qu’on le garde au frais (4°C). Il est peut-être utile de préciser que tout stockage au frigo sans emballage parfaitement hermétique fera sécher très rapidement votre pain.
Enfin, le sac en papier est également une alternative intéressante, dans le sens où il est plus hermétique qu’un sac en tissu, tout en étant capable d’absorber une partie de l’humidité ambiante excédentaire (pour autant que le papier ne soit pas plastifié). Il peut donc représenter un bon compromis pour autant que sa fragilité ne vous amène pas à le déchirer rapidement.
"Dans tous les cas, gardez en tête que le séchage est ralenti par l’hermétisme du contenant (plus ou moins poreux), qui augmente l’humidité ambiante de stockage et favorise in fine l’apparition des moisissures.
Moisissures et congélation
Les moisissures
Les moisissures qui peuvent apparaitre après cuisson sont du fait de l’environnement externe au fournil (les champignons ne survivent pas à la durée et aux chaleurs de la cuisson). En outre, même si un pain au levain (plus acide qu’un pain à la levure) présente un terrain moins propice aux moisissures, il possède tout les éléments nécessaires au développement de la vie (assez d’eau, de nourriture et d’oxygène). Dès lors, il est important d’assurer une hygiène minimale aux contenants que vous employez. Pour éviter les champignons dans le sac en lin, il peut être utile de le nettoyer de temps en temps (en machine avec vos habits ou torchons). Votre boite à lait pourrait se voir étaler un peu de vinaigre à l’aide d’un chiffon, tout comme l’espace où vous déposez le pain dans votre cuisine ainsi que les caisses de nos vélos.
Par ailleurs, comme expliqué ci-dessus, il faut éviter les contenants trop hermétiques qui produisent des environnements chauds et humides.
Dès lors que les moisissures apparaissent, il peut être utile de couper la première tranche du pain et d’observer si des filaments (spores) ont été créés par les champignons. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à passer le reste de votre pain dans un four chaud (180/200°C) pendant une dizaine de minutes et vous pourrez le manger sans problème.
La congélation
Dans le cas où vous devez stocker votre pain pour une période supérieure à 4 jours, nous vous encourageons à le congeler. Comme décrit précédemment, la congélation empêche tout à la fois le séchage et le rassissement du pain. Bien évidemment, si vous congelez un pain déjà séché ou rassis, cela ne servira à rien. Il est donc conseillé de vous demander si vous comptez manger l’entier de votre pain dès sa réception.
Pour réussir une congélation optimale, il est nécessaire de pré trancher toute la partie du pain qui sera congelée. Congeler un pain entier est effectivement une mauvaise idée, car vous consommerez plus d’énergie et votre congélation se fera lentement (le froid s’heurte à l’inertie thermique de la section du pain. Plus elle est grande et plus le froid entre lentement). Dès lors que le froid ne saisit pas rapidement la masse, l’eau se solidifie sous la forme de gros cristaux d’eau, ce qui a tendance à détériorer la fibre du pain. En se décongelant le pain peut s’émietter voir carrément se désagréger. Outre la qualité du pain, une congélation trop lente peut avoir des conséquences sur le plan de l’hygiène.
Enfin, si votre stock de pain se présente sous la forme de tranches, il sera plus aisé de le proportionner en fonction de vos besoins.